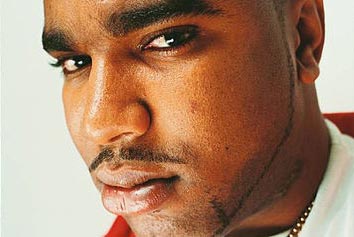George Pelecanos aime la musique noire américaine. Dans ses romans, elle occupe une place prépondérante. Il ne se contente pas de signaler que ses personnages écoutent la radio ou un disque, mais les fait discuter de musique, théoriser, acheter des albums, les classer par labels et années de sortie…
« – C’est ce passage-là, dit Quinn en montrant du doigt le lecteur de cassettes de la Chevrolet de Strange.
– Il dit : « Hug her ».
Strange fredonna les paroles :
– « Makes you want to love her, you just got to hug her, yeah. »
– « You just got to fuck her. », dit Quinn. C’est ce qu’il dit. Rembobine la chanson et écoute-la encore une fois.
(…)
– Ecoute, Terry, tu t’obsèdes sur des détails. Par une si belle journée, tu ferais mieux de te laisser porter par la chanson. C’est avec cet album que les Spinners ont débuté chez Atlantic. Certains disent que c’est le plus bel album de soul philadelphien qu’on ait jamais enregistré. »
– Oui, je sais, produit par Taco Bell.
– THOM Bell ! »
– Et ces deux mecs dont tu parles tout le temps, Procter et Gamble ?
– Gamble et Huff. N’empêche, cette musique, c’est le pied. Bon dieu, Terry, il aurait fallu que tu sois…
– … que je sois là, je sais.
– Exactement. Il suffit de rassembler tous les groupes qui jouaient surtout des chansons langoureuses en ce temps-là, les Chi-Lites, les Stylistics, Harold Melvin et Earth, Wind & Fire quand ils faisaient des morceaux lents, et on obtient la plus magnifique période de pop musique de toute l’histoire. C’est comme si l’Amérique avait enfin créé… sa forme d’opéra à elle, tu vois.«
(George Pelecanos, « Soul Circus », 2003)
C’est un détail de son style d’écriture qui doit, à la longue, agacer plus d’un lecteur. Mais qui m’enchante. Mieux : Pelecanos écrit les livres que je rêve d’écrire. De la même manière que Tarantino réalise les films que je rêve de réaliser. Et il y a du Tarantino dans Pelecanos, et vice versa. Dans cette manie du détail, dans cette volonté de placer des références culturelles populaires. Les discussions entre Derek Strange et son ami Terry Quinn ne sont pas foncièrement différentes de celles entre les gangsters de « Reservoir Dogs » sur le sens caché d’un morceau de Madonna ou de Pam Grier et Robert Forster sur les Delfonics (« Jackie Brown »). Il s’agit toujours de digressions n’ayant rien à voir avec l’intrigue centrale, mais qui permettent de mieux cerner les personnages et leur « background ».
C’est ce détail qui fait toute la saveur des romans de Pelecanos, leur âme. Qui permet un prolongement du roman, si l’on est un peu curieux. Et nous devons être un certain nombre dans ce cas-là, puisque les traducteurs de « Soul Circus » avaient pris la peine de lister, à la fin de l’ouvrage, tous les titres de chansons cités.
Ecrit par Julien




 Publié par Rémi Guyot
Publié par Rémi Guyot